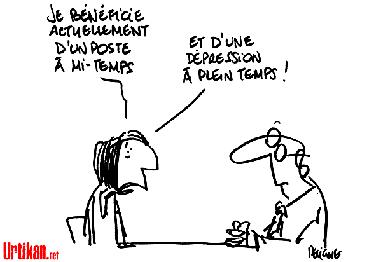Au Royaume-Uni, le contrat « zéro heure », degré zéro de l’exploitation du travail
(http://echangesmouvemen.canalblog.com/archives/2014/01/05/28865808.html)
Sur le blog : ECHANGES et MOUVEMENT (http://echangesmouvemen.canalblog.com/)
Extraire le plus possible de valeur de la force de travail
(Cet article est paru dans Echanges n° 145, automne 2013.)
Au moment du vote à l’arrachée de la loi Macron par le parlement, il nous a paru intéressant de relayer cet article du blog Echanges et Mouvement qui montre bien pourquoi et comment la crise du capitalisme mondialisé entraine un dérèglement généralisé des conditions de travail et conduit à la désintégration des rapports sociaux….
« Les politiciens ont transformé le travail en une marchandise, guère différente de la viande de cheval » (1)
UN NOUVEAU VENU DANS LA JUNGLE DES RELATIONS TRAVAIL-CAPITAL
Le contrat de travail « zéro heure » connaît une forte expansion au Royaume-Uni. Ce contrat, qui ne fixe aucun horaire de travail – l’employé accepte de se déplacer à tout moment où il y a du travail à faire en étant rémunéré à l’heure –, est le nouveau venu dans les conditions d’exploitation de la force de travail. Il n’est pourtant qu’une étape d’une longue évolution dans laquelle se combinent les éléments de base de cette exploitation : salaire, temps de travail et rythme de travail. Ces éléments sont interdépendants aux différents stades entre domination formelle et domination réelle et peuvent coexister dans une même économie nationale. Avant d’examiner cette dernière vicissitude du contrat de travail, rappelons ce que sont les données simples qui forment la base même du capitalisme, bases trop souvent ignorées dans les tentatives de comprendre les dérives complexes du système.
Ce système est basé sur la production de marchandises, lesquelles sont acheminées vers des points de vente au moyen de transports. Cette production est assurée par un producteur quelconque (de l’artisan à une multinationale exploitant jusqu’à plus d’un million de travailleurs) qui, sauf le cas de l’artisan individuel, emploie ces travailleurs pour façonner des matières premières généralement à l’aide de machines et fabriquer une marchandise quelconque. Lors de la vente de cette marchandise, le producteur, le capitaliste, entend récupérer un supplément, outre son investissement en matières premières, l‘amortissement des machines, les autres dépenses de fonctionnement de son usine. Ce supplément, la valeur, correspond à ce qui y a été ajouté par l’exploitation de la force de travail, exploitation sans laquelle la marchandise n’existerait pas. L’opération globale n’est accomplie que pour dégager un profit qui empêche la dévalorisation du capital engagé et pour avant tout accroître ce capital, ce qui suppose que cette valeur soit améliorée constamment pour assumer la concurrence.
Ce supplément est accaparé par le « producteur » sous forme monétaire ; le travailleur, fournisseur de la force de travail n’y a aucun accès et aucun droit. Ledit producteur en utilise une partie pour la rémunération de la force de travail, rémunération fixée au minimum au niveau suffisant pour assurer la reconstitution de cette force de travail. Bien sûr, le producteur capitaliste cherche à réduire le plus possible cette ponction sur la valeur. Ce qu’il conserve il le garde pour lui ou le distribue aux actionnaires, une partie pouvant être mise en réserve pour des investissements dans l’entreprise.
LA TRILOGIE DE LA PRODUCTIVITÉ : TEMPS ET RYTHME DE TRAVAIL, SALAIRE
Dans cet article, nous n’examinerons pas le dysfonctionnement fondamental qui résulte du fait que le travailleur ne récupère pas l’essentiel de la valeur créée par son activité et les conséquences déstabilisantes qui en résultent pour l’ensemble du système capitaliste. Il y a aujourd’hui un retour à l’exploitation pure et simple de la force de travail mise en concurrence à l’échelle du monde qui est principalement le résultat de l’explosion des frontières et du déplacement extrêmement rapide de la finance avide de toute spéculation. Nous nous attacherons uniquement à cette relation entre le travail et le capital et le conflit permanent autour de la trilogie : temps de travail, rythme de travail et salaire.
Dans l’histoire du capitalisme ces facteurs déterminants pour le niveau de la valeur ont pu évoluer indépendamment et/ou simultanément, selon le rapport de forces capital-travail, les techniques mises en œuvre et les transformations corrélatives dans les conditions d’exploitation du travail – tout un ensemble sur lequel le capital a toujours la haute main, se révolutionnant lui-même dans sa dynamique ; le maintien de l’ordre social nécessaire au bon fonctionnement du système étant assuré par les structures politiques à l’intérieur d’un Etat.
Schématiquement, si l’on excepte les périodes de crise dans une industrie ou dans un Etat, dans le monde, les tendances depuis la montée en force du capitalisme montraient une intervention sur l’un ou l’autre élément, ou sur plusieurs à la fois, pour ce qui est présenté comme un facteur unique dans la compétition capitaliste : la productivité du travail. Le leitmotiv dont on nous rebat les oreilles sur l’accroissement de cette productivité n’est en fait que la tentative d’accroître la valeur et la part de cette valeur conservée par le capital. Si la production de valeur concerne uniquement le secteur productif (production de marchandises), l’accroissement de la productivité concerne aussi le secteur non productif, qui n’existe que par la valeur dégagée dans le secteur productif ; là aussi, il importe de réduire cette amputation de la plus-value. Ceci pour conclure que la pression sur la productivité du travail s’applique à l’ensemble des activités touchant à l’exploitation de la force de travail.
Après une période de précarité totale pour le travailleur, où le producteur faisait la loi quant aux temps, rythme et salaire, sans se soucier de la reconstitution de la force de travail (le réservoir de force de travail étant assez important pour parer au remplacement des « éliminés » du surmenage et de la misère), la situation s’est lentement modifiée, pas par commisération ou humanisme, mais en partie en raison de la montée de la lutte de classe et en partie de l’évolution du capital lui-même.
TAYLORISME ET FORDISME : L’ESPOIR DU CAPITAL
Pendant près d’un siècle, malgré les crises périodiques et la crise majeure des années 1930, l’introduction du machinisme. (machine à vapeur et électricité) a profondément marqué l’évolution du capitalisme. Le taylorisme et le fordisme – qui ne purent exister qu’après l’introduction du machinisme – constituaient une tentative de dépasser les crises et de réguler la production capitaliste. Le travail sur la chaîne permettait une régulation de deux éléments temps et rythme et une production de masse accrue à bas coût dont les augmentations de salaire permirent l’absorption. De même, la diminution du temps de travail autorisait l’utilisation des marchandises accessibles dans les loisirs ainsi concédés aux travailleurs.
Malgré la crise de 1930 que la seconde guerre mondiale sembla résoudre par l’importance des destructions, tant en capital fixe qu’en capital variable, l’expansion du fordisme s’étendit à l’ensemble des pays développés : en France, en retard par rapport à l’évolution des Etats-Unis par exemple, ce furent les « trente glorieuses » dans lesquelles le système fonctionna sur cette base fordiste. Avec l’accompagnement dans la plupart des secteurs économiques d’une réduction du temps de travail, d’une modération du rythme de travail et des salaires suivant une progression notamment eu égard à l’inflation.
QUAND L’INFORMATIQUE BOULEVERSE LE MONDE CAPITALISTE
Dans les années 1970, un autre facteur vint bouleverser ce qui semblait la « vitesse de croisière » du capital (indépendamment du problème fondamental de la production capitaliste évoqué ci-dessus) : l’introduction de l’automatisation, qui vida les usines des travailleurs sans spécialisation, un des éléments essentiels du « compromis fordiste ». Le déséquilibre résultant de cette nouvelle situation (notamment quant à la nécessité d’extraire plus de valeur [2] pour compenser les investissements dans l’appareil productif) a amené le capital à chercher de nouvelles sources de valeur.
Le développement des transports, principalement maritimes (le conteneur), a permis le transfert d’industries entières consommatrices de capital variable dans les contrées où un important réservoir de main-d’œuvre permettait un retour aux conditions primaires d’exploitation. C’est-à-dire une surexploitation dans le temps et le rythme de travail, et la possibilité de négliger totalement, par de faibles salaires, la reconstitution de la force de travail : le travailleur, épuisé ou atteint physiquement, éjecté du circuit productif, pouvant être immédiatement remplacé sur les mêmes chaînes de production que celles du compromis fordiste, mais sans limite de temps de travail et à des cadences infernales pour des salaires incomparablement faibles.
Il n’est ainsi nullement nécessaire que le travailleur consomme sa production, puisque celle-ci est presque totalement exportée vers les pays industrialisés (le produit de ce travail devant permettre de rembourser les investissements étrangers ou les prêts bancaires).
Cette nouvelle orientation du procès de production capitaliste, le retour à ces conditions primaires de l’exploitation capitaliste (sous la forme de la domination formelle mais dans un contexte totalement différent) contraste avec ce qui subsiste (essentiellement dans les pays industrialisés) du compromis fordiste. Ces conditions d’exploitation ont eu un effet boomerang sur les conditions encore existantes dans les pays industrialisés, ceux-ci se trouvant contraints, pour éviter de nouvelles délocalisations, d’attaquer sous tous les angles – temps, rythme et salaires – ce qui subsistait de ces conditions.
Comme il n’était pas possible, en raison des résistances ouvrières, de mener cette attaque de front sur ces trois éléments, celle-ci se fit progressivement, élément par élément, pour en arriver aujourd’hui, entre autres, à ce contrat de travail zéro heure (ou à des situations similaires dans d’autres pays industrialisés) où l’on trouve concentrée l’attaque à la fois sur les trois éléments de la productivité.
FLUX ET REFLUX DE L’INTÉRIM
Ce terme actuel n’est que la dernière étape d’un processus engagé voilà plus de trente ans, plutôt comme un grignotage dans des secteurs distincts qui, au fil du temps, s’est accentué. Une des premières étapes a été le développement de l’intérim qui d’ailleurs ne fit à ses débuts qu’assurer la transition vers l’automatisation. Toutefois, jusqu’à une date récente, le travail intérimaire a été aussi utilisé comme volant d’appoint pour permettre d’adapter le besoin en main-d’œuvre aux fluctuations de la production : il y avait là une incursion vers le temps global de travail et vers les salaires, un intérimaire étant le plus souvent moins payé qu’un travailleur permanent. Quant au rythme du travail, c’était celui de l’entreprise dans laquelle l’intérimaire s’intégrait ; il y avait pourtant une pression indirecte sur l’intérimaire pour mieux respecter ces normes internes de production en raison de la précarité de cette forme de travail.
Ce travail intérimaire n’a pas disparu mais il a diminué en raison du développement d’autres formes de précarisation qui jouent sur l’ensemble des éléments concourant à la productivité. L’intermède en France de la loi sur les 35 heures n’a pas touché seulement le temps de travail mais a abouti par diverses manipulations à un accroissement de la productivité horaire individuelle : le seul reproche qui pouvait lui être fait sur ce terrain était que les entreprises ne pouvaient, en raison d’autres dispositions légales, accroître indéfiniment le temps de travail qui aurait permis de profiter pleinement de ce gain de productivité. Le système Sarkozy de défiscalisation des heures supplémentaires pallia quelque peu cet inconvénient au profit du capital.
Parallèlement à l’utilisation massive de l’intérim (jusqu’à la moitié des effectifs), s’est développé tout aussi massivement le CDD (contrat à durée déterminée) qui s’oppose au CDI (contrat à durée indéterminée). Ce n’était pas vraiment un nouveau venu mais son utilisation est restée dans les années 1970 limité à des secteurs marginaux (comme les intermittents du spectacle). A ce moment-là, la distinction entre ces deux formes de contrats touchait essentiellement le temps de travail et indirectement le rythme du travail et le salaire en raison de la pression qu’une situation précaire exerçait sur un travailleur intéressé avant tout par le renouvellement de son contrat et/ou le passage en CDI. A cette époque, le terme CDD était quasi inconnu, la pratique depuis trente années étant le CDI réglementé par des conventions collectives de branche.
VIDER LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Les conventions collectives sont alors apparues comme un carcan dont le capital devait absolument se séparer : elles ont volé en éclats, remplacées par d’autres conventions dont les termes vagues permettaient l’introduction de toutes formes de contrat et à travers elles la disparition des automatismes réglant les salaires, remplacés par le salaire « au mérite », qui n’est rien d’autre que la possibilité pour le capital de moduler les salaires unilatéralement, en fonction de l’intérêt que le travailleur concerné présente pour l’entreprise en même temps que sa docilité, et même sa participation, quant au temps et au rythme de travail. Le CDD a proliféré (et prolifère encore) sous d’innombrables variations, entièrement adaptées aux nécessités économiques et techniques de chaque entreprise.
En France, il y a plus d’une cinquantaine de formes de CDD et on en crée encore, notamment pour des buts politiques spécifiques, par exemple pour résorber le chômage (emplois jeunes ou contrats de générations).
EN FRANCE, L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE JANVIER 2013 ET LA LOI DE JUIN
Une des dernières trouvailles permettant d’échapper au carcan de la réglementation du travail (qui reste de la période fordiste) est en France la loi de juin 2013, dite « de sécurisation de l’emploi » qui incrit dans le code du travail l’Accord national interprofessionnel (ANI) signé en janvier de la même année par trois organisations syndicales et l’organisation patronale Medef. Le code du travail s’en trouve profondément modifié, et permet en fait dans certaines circonstances d’ignorer totalement les barrières à l’arbitraire patronal sur les éléments de la productivité.
D’un côté, ce texte légalise le temps partiel à une limite plancher de 24 heures par semaine, mais avec tant de possibilités de dérogations qu’en fait une entreprise pourra très légalement proposer des contrats de n’importe quelle durée inférieure à cette limite. De l’autre, l’ANI prévoit que des accords d’entreprise pourront pour un temps, « si l’entreprise présente des difficultés conjoncturelles », écarter toutes les dispositions légales concernant la durée du temps de travail, le rythme de travail et baisser les rémunérations (avec un plancher de 1,2 smic).
Peu de temps après l’adoption de la loi, des entreprises comme Sanofi, Canon ou Natixis ont engagé des pourparlers, prétendant se trouver dans la situation leur permettant d’outrepasser les dispositions légales. En août, deux accords de ce genre ont été conclus impliquant des réductions de salaires et leur gel, le travail du week-end et de nuit, l’abandon de RTT, etc. (3).
LA SECURISATION DE L’EMPLOI EN QUESTION
Les syndicats patronaux, encouragés par cette brèche, voudraient en quelque sorte généraliser ces dispositions et écarter toutes dispositions contraignantes concernant les trois éléments de la productivité. En décembre 2013 s’ouvrent des négociations sur la « sécurisation de l’emploi ». Certains syndicats ont déjà accepté des propositions du Medef qui prévoient une généralisation de l’intermittence pour les entreprises de moins de 50 salariés et une extension des contrats de chantiers et de projet En même temps d’autres « innovations » se font jour, qui toutes prétendent résorber le chômage, proposant des solutions qui permettent d’échapper aux contraintes de la réglementation nationale sur le contrat de travail. En partie, ces innovations ne sont rendues possibles que par l’expansion foudroyante de l’informatique. L’une d’elles utilise une loi de 2009 autorisant le prêt de salarié d’une entreprise à une autre quelconque, avec « l’accord » du salarié coincé entre acceptation et licenciement ; un site internet récent, Flexojob, se propose de répandre cette pratique à l’échelle internationale.
Cette même échelle internationale apparaît dans le « cloud working » : chaque jour sur Internet un site offre des travaux à faire immédiatement à domicile par un « indépendant ». Bien sûr, cela ne concerne que des tâches comme programmeur, rédacteur, traducteur, graphiste, etc. C’est une version des contrats déjà existants de chantier ou de projet non-salariés, c’est-à-dire sans aucune garantie sociale (en France, IBM s’est lancé en 2012 dans la pratique du cloud working sous le titre « program liquid » qui lui permettrait, en confiant des tâches à des sous-traitants sous statut d’auto-entrepreneurs, de réduire ses effectifs mondiaux de 400 000 employés actuellement à 100 000). Cette résurgence du travail à domicile est liée au développement de l’informatique individuelle (ce qui déplace la question du capital fixe) et a aussi des conséquences sociales.
LE CONTRAT « ZERO HEURE » : UNE MISE EN JACHERE DE LA FORCE DE TRAVAIL
L’exemple en ce sens qui nous vient d’Outre-Manche, le contrat « zéro heure », peut apparaître comme une variante plus perfectionnée de l’intérim ou de l’intermittence dans les professions du spectacle et de l’audiovisuel. En fait, ce type de contrat supprime tout intermédiaire entre le travail et le capital et accroît au maximum l’utilisation de la force de travail dans un temps déterminé pour un salaire brut de tous ses accessoires protecteurs du porteur de cette force de travail.
En quoi consiste le contrat « zéro heure » ? La définition en est donnée par une entreprise proposant sur Internet des formules de contrat (4) :
« L’employé “zéro heure” est celui qui accepte que l’employeur n’ait pas forcément à lui donner du travail mais que, s’il y a du travail à faire, l’employé est contraint de l’accepter. Ce contrat est pour un employé qui n’a pas d’horaires fixes de travail et qui accepte de travailler au jour le jour. »
Ce type de contrat est parfaitement valable et conforme aux dispositions de l’Employment Rights Act de 1996, pourvu qu’il soit consigné par écrit (5). Le contrat peut être temporaire ou permanent. Dans ce dernier cas le travailleur est dans l’obligation d’être disponible 24 heures sur 24, c’est-à-dire accroché à son portable, car son employeur peut l’appeler à n’importe quel moment pour l’exploiter tout le temps qu’il juge nécessaire sans même une spécification à l’avance d’une période ou d’un horaire (6).
Le salaire n’est évidemment versé que pour le temps effectivement travaillé. Il semble que le contrat « zéro heure » se soit développé come moyen de tourner l’obligation prévue par la National Minimum Wage Regulation de payer le salaire minimum légal à tout salarié présent sur le lieu de travail, quelle que soit son activité durant ce temps. De plus, ledit salaire ne comporte aucun supplément pour ce que l’on appelle les avantages sociaux depuis la maladie, la retraite jusqu’à la cantine ou toute autre invention d’autrefois pour attirer le salarié.
Quant au rythme de travail, c’est bien sûr celui imposé par l’employeur. Il est bien évident que le chômeur qui, dans cette période de marasme économique et de chômage élevé (7), « bénéficie » d’un contrat « zéro heure » va faire tout son possible pour satisfaire les impératifs de l’employeur, faisant preuve d’un zèle inhabituel et espérant, grâce à la bonne opinion que son patron aura ainsi de lui, d’obtenir sinon un CDD ou un CDI, un plus grand nombre d’heures ou des appels plus fréquents. Mais certains patrons ne se fient guère à cette perspective de pression indirecte et imposent parfois dans ce contrat une discipline très stricte pour être sûr que le salaire versé correspond bien à la totalité du temps supposé être travaillé. Parfois cet exploité « zéro heure » est soumis à une discipline avec un système de points de pénalisation : on est pénalisé si on parle à son voisin durant le travail, si on va trop souvent ou reste trop longtemps aux toilettes, si on s’absente dans la période de temps travaillé ou si l’on est en retard, etc. Un certain nombre de points ne signifie pas directement la porte mais la fin de la période de travail et le silence total du téléphone. C’est l’application du principe « Three strikes and you are out » (trois infractions et vous êtes dehors). Bien sûr il n’en résulte aucune indemnisation puisque formellement on n’est jamais licencié ; simplement, on n’est plus jamais appelé.
Pour faire croire à un équilibre entre partenaires, les zélateurs du contrat « zéro heure » prétendent que, sous ce contrat, le travailleur a la possibilité de refuser une proposition de travail ou de débrancher temporairement son téléphone. C’est ignorer que, comme dans tout contrat de travail quel qu’il soit, le capitaliste dispose d’un pouvoir absolu et peut toujours régler une situation dans son intérêt. Ce qui signifie que le refus d’un travail ou le silence téléphonique entraîne un licenciement de fait.
LE CONTRAT « ZERO HEURE » EST-IL UN EPIPHENOMENE EN GRANDE-BRETAGNE ?
Il est difficile de se faire une idée exacte de l’étendue de ce type de contrat. Comme le soulignent nombre de commentateurs : beaucoup de travailleurs ne savent qu’ils sont en « zéro heure » et nombre de ces contrats ne sont pas signalés aux autorités. Ce qui fait que les chiffres donnés varient selon les sources de 250 000 à 1 million de travailleurs, certaines mentionnant des chiffres de 5,5millions à la quasi-totalité des salariés du privé (8). Ce qui est certain, c’est qu’il est en croissance rapide : cinq fois plus important en 2012 qu’en 2011 avec un transfert des contrats permanents en contrats « zéro heure » qui permet de moduler les horaires et d’évacuer l’indemnisation du chômage technique.
Il comporterait même des variantes : par exemple, d’après des estimations syndicales, plus de 5 millions de travailleurs auraient signé des contrats de travail permanents ne leur garantissant que trois heures de travail par semaine.
Actuellement, le temps de travail hebdomadaire sous ce régime serait de dix-neuf heures. Le salaire moyen des « zéro heure » est sensiblement inférieur à celui des travailleurs à temps complet : 11 euros de l’heure contre 18 euros. Il toucherait autant les femmes que les hommes, autant les 18-25 ans que les 25-49 et les plus de 50 ans.
A ses débuts, le contrat « zéro heure » a touché les branches d’industrie connaissant de grandes variations saisonnières : hôtellerie, restauration, loisirs et éducation, santé. Mais peu à peu il a gagné l’ensemble des secteurs avec une propension vers les services à la personne de toutes sortes (services municipaux d’entraide, santé, éducation). Des emplois non qualifiés, il s’est aussi déplacé vers les emplois qualifiés (cadres, techniciens, ingénieurs qui seraient à 43 % sous ce régime). Il toucherait actuellement, sous toute réserve, plus de 20 % des entreprises britanniques.
Parmi les entreprises qui parfois y ont mis la totalité de leur effectif, c’est un inventaire à la Prévert : chaînes de restaurants, fastfood, pharmacies, habillement, distribution (y compris Amazon qui l’utiliserait comme une sanction), services publics comme le National Trust, nombreuses municipalités (97 % d’entre elles), l’audiovisuel, la Tate Gallery et le Palais de Buckingham (qui imposerait même l’obligation de n’avoir qu’un seul contrat « zéro heure) et la Fondation Diana (9).
PROFITS ET PERTES
Les profits sont évidemment pour le capital dans son ensemble qui peut moduler l’utilisation de la force de travail et l’utiliser si besoin de manière à ce que le temps payé soit productif au maximum. Cela lui permet de réduire le coût de production et de tendre à un taux maximum de productivité. Les pertes sont pour les travailleurs dans leur ensemble. Les zélateurs ne manquent pas d’insister sur le fait que pour des catégories bien limitées – les adolescents et les vieux – l’attrait de gagner quelques sous sans avoir à prendre un emploi permanent à plein temps peut constituer une motivation d’adhérer à ce système. Mais pour l’immense majorité des travailleurs qui cherchent dans ce système une position stable et un salaire régulier, le contrat « zéro heure » est une catastrophe (au même titre que le chômage ou que tout autre emploi précaire).
Outre les problèmes familiaux (par exemple la garde des enfants) qui peuvent soulever d’insurmontables difficultés, c’est l’ensemble des conditions matérielles de la vie sociale d’aujourd’hui qui deviennent inaccessibles : accès à un logement, carte de crédit, emprunts, etc. De plus, la disponibilité constante est une restriction totale de liberté : autrefois, cette restriction ne touchait que la présence dans les murs de l’entreprise ; avec le contrat « zéro heure » l’enfermement n’est plus derrière des murs mais dans la contrainte d’une « présence téléphonique » et d’une disponibilité immédiate, ce qui restreint considérablement l’espace de liberté. Tout comme un prisonnier sur parole astreint à résidence (10).
Les résistances à cette évolution des conditions de travail ne sont que sporadiques. La lutte dans une boulangerie industrielle Hovis contre des licenciements et corrélativement l’embauche sous contrats « zéro heure » n’a finalement abouti qu’à un accord avec les syndicats mettant ces contrats sous conditions. D’un autre côté les syndicats et le Labour Party social-démocrate ne peuvent guère faire autre chose que dénoncer l’extension de ces contrats et promettre qu’ils les interdiraient ou réformeraient si jamais l’opposition travailliste revenait au pouvoir. Mais pour le moment ils ne peuvent pas dépasser le stade des « prises de position » : la majorité conservatrice se félicite au contraire de cette « avancée » dans la liberté totale d’exploitation de la force de travail.
DES CONSEQUENCES IMPREVUES : LA DESINTEGRATION DES RAPPORTS SOCIAUX
Cette précarité totale, dans la mesure où elle touche un pourcentage de plus en plus important de la population, touche également l’ensemble des structures sociales édifiées depuis près d’un siècle sur la base d’une majorité avec un emploi permanent et un revenu régulier (partie du compromis fordiste). Un seul exemple récent, en France : la pression pour l’ouverture des magasins la nuit et les week-end ne viendrait-elle pas, par-delà les polémiques sur le temps de travail, le repos dominical, etc. d’une nécessité sociale causée par l’expansion de cette précarité qui ne reconnaît plus de régularité dans aucun domaine ? A la désintégration de l’organisation traditionnelle du travail correspond une désintégration des structures et des rapports sociaux. On pourrait épiloguer longtemps sur de telles conséquences, qui sont certainement en train de se dérouler sous nos yeux. Mais ceci est un autre sujet . Et un sujet d’études et d’approfondissement.
H. S.
ANNEXE
Jusqu’à la mort
Un cas particulier dans une activité spécifique, mais qui illustre la pression globale s’exerçant sur toute force de travail, qu’elle soit disponible ou en réserve.
Le 21 août 2013 à Londres, un stagiaire allemand devait prouver la sincérité de sa candidature d’employé à la succursale de la Bank of America. Pour ce faire il a accepté de travailler jour et nuit, jusqu’à 72 heures non-stop. Il en est mort d’épuisement. A la suite de la médiatisation de ce « fait divers », les langues se sont quelque peu déliées et il est apparu que dans certains secteurs, c’était une pratique courante de travailler jusqu’à 22 heures (parfois plus tard) après avoir embauché le matin à 9 heures (et que le contrat « zéro heure » permettait ce genre de pratique).
Selon un ancien stagiaire, le plus grand cauchemar des intéressés est ce que les salariés concernés appellent « le manège enchanté ». Après avoir travaillé toute la journée depuis 9 heures et une partie de la nuit jusqu’au petit matin, un taxi vous ramène au domicile pour que vous puissiez prendre une douche, vous changer et reprendre le taxi qui vous attend pour repartir pour une autre journée de turbin.
NOTES
(1) Citation du magazine allemand Stern reprise dans le Financial Times du 1er mars 2013. Il est réjouissant de voir la presse capitaliste reconnaître que la force de travail n’est pour le capital qu’une marchandise, traitée avec des manipulations semblables à celles découvertes pour la viande (le cheval moins cher remplaçant anonymement le bœuf dans des préparatios industrielles). Mais elle contient une erreur : les politiques ne sont jamais que les agents d’exécution des nécessités présentes du capital.
(2) La montée en capital fixe exige toujours un élargissement du marché pour compenser la baisse du taux de profit, la fameuse taille critique ; la règle est que le prix de la force de travail est de plus en plus faible parce qu’il y a hausse de la productivité grâce au machinisme mais baisse globale du taux d’exploitation produisant de la plus-value.
(3) Le Monde, 8 août 2013 : « Flex sécurité, les premiers accords dans les entreprises ». Les RTT (réductions du temps de travail) résultent de l’application de la loi sur les 35 heures de travail par semaine qui permet au travailleur de cumuler des journées de repos payées qu’il peut prendre tout au long de l’année.
(4) The Employment Document Company (http://www.employmentdocumentcompan… ). Le contrat type offert ne comporte pas moins de 11 pages et 29 articles.
(5) La réglementation du travail est bien moins étendue qu’en France, une bonne partie des conditions de travail étant régies par la coutume professionnelle et le rapport de forces au sein de l’entreprise.
(6) En anglais cela se traduit par être « in call ».